• Glossaire
• Article précédent
• Article suivant
Une page en attente de résultats probants
Le problème de la classification des chapiteaux est
complexe. Il semblerait en effet que la forme idéale a été
trouvée un peu tardivement vers le XIesiècle.
Cette forme idéale on la trouve ci-dessous dans l’image
1 d’un chapiteau de Notre-Dame-la-Grande de
Poitiers. Une forme reproduite presque à l’identique (à
l’exception des décors très variés) sur tous les chapiteaux
durant les XIe et XIIesiècles.
Rappelons que, à la différence de l’imposte, qui est une
pierre unique, le chapiteau est toujours associé à une
pierre qui le surplombe, le tailloir. C’est ce couple de
pierres qui aurait remplacé l’imposte. La forme « idéale «
semble être la suivante : le tailloir est à plan
rectangulaire et s‘évase vers le haut. Sa hauteur est
environ le tiers de celle du chapiteau. Le chapiteau, quant
à lui, est posé sur une pilier à plan circulaire (s’il est
isolé) ou à plan semi-circulaire s’il est adossé à un mur ou
à un autre pilier plus massif. Le diamètre de la base du
chapiteau est le même que celui du pilier et environ les
deux tiers de la largeur du sommet du chapiteau. Lequel
sommet coïncide avec la base du tailloir.
Il semblerait bien que ce soit cette forme qui soit la mieux
adaptée, minimisant simultanément les pressions exercées sur
les pierres et les coûts de fabrication.
Auparavant, il y a sans doute eu beaucoup d’essais afin de
trouver la formule idéale. C’est ce que l’on voit dans les
images suivantes.
Il est très difficile, à partir du trop petit nombre
d’exemples que nous avons sous les yeux, d’effectuer une
classification et d’envisager une datation. En particulier,
l’apparence fruste ou archaïque d’une œuvre n’est pas
significative d’une réelle ancienneté. Ainsi le chapiteau de
l'image 18 de
Toulon-sur- Arroux (XIesiècle ?) pourrait être
beaucoup plus récent que le chapiteau de l'image
10 de San Pedro de la Nave attribué au VIIe
ou VIIIesiècle.
-
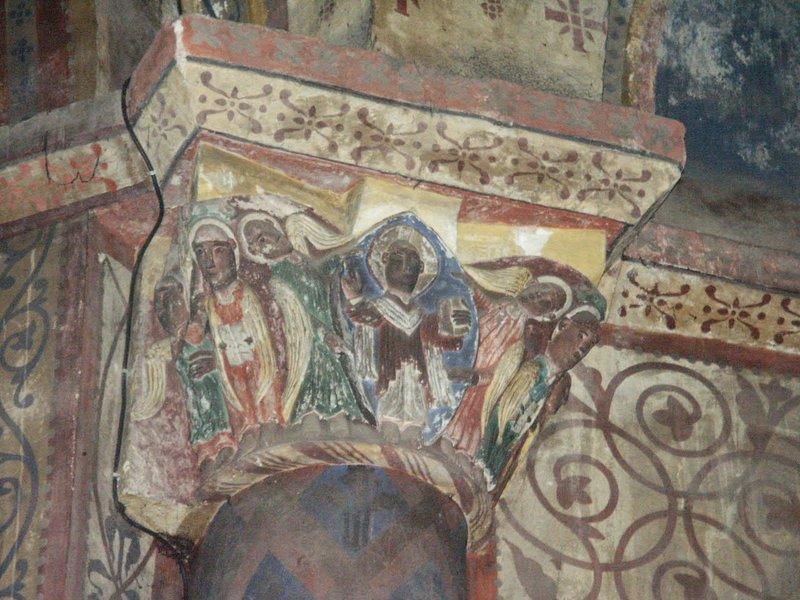
Église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers :
chapiteau de l’Ascension. Exemple de
chapiteau « classique » du XIe
– XIIesiècle.
Image 1
Église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers :
chapiteau de l’Ascension. Exemple de chapiteau
« classique » du XIe– XIIe
siècle.
-

Église San Marco à Rossano (Calabre -
Italie) : cuve baptismale creusée dans un
chapiteau cylindrique.
Image 2
Église San Marco à Rossano (Calabre - Italie) :
cuve baptismale creusée dans un
chapiteau cylindrique.
-

A Saint-Léonard-de-Noblat (Limousin),
chapiteau de forme parallélépipédique.
Comparer ses dimensions à celles de son
tailloir situé au dessus de lui.
Image 3
A Saint-Léonard-de-Noblat (Limousin),
chapiteau de forme parallélépipédique.
Comparer ses dimensions à celles de son
tailloir situé au dessus de lui.
-

A Notre-Dame de Roubignac, commune d’Octon
(Hérault- Languedoc). Comparer les
dimensions du chapiteau et du tailloir.
Image 4
A Notre-Dame de Roubignac, commune d’Octon
(Hérault- Languedoc). Comparer les dimensions du
chapiteau et du tailloir.
-

Chapelle de la Redorte (Aude-Languedoc).
Image un peu floue due au manque
d’éclairage. Chapiteau de forme
parallélépipédique (probablement
wisigothique).
Image 5
Chapelle de la Redorte (Aude-Languedoc).
Image un peu floue due au manque d’éclairage.
Chapiteau de forme parallélépipédique
(probablement wisigothique).
-

A Loupian (Hérault- Languedoc), église
Saint-Hippolyte. Remarquer que le bas du
chapiteau (astragale) épouse la forme de la
colonne du dessous, comme dans l’image
suivante.
Image 6
A Loupian (Hérault- Languedoc), église
Saint-Hippolyte. Remarquer que le bas du chapiteau
(astragale) épouse la forme de la colonne
du dessous, comme dans l’image suivante.
-

A Lautenbach (Alsace). On voit à gauche une
imposte sur un pilier à section
rectangulaire et à droite l’association
chapiteau-tailloir sur pilier cylindrique.
Les deux formules ont pu coexister.
Image 7
A Lautenbach (Alsace). On voit à gauche une
imposte sur un pilier à section rectangulaire et à
droite l’association chapiteau-tailloir sur pilier
cylindrique. Les deux formules ont pu coexister.
-

A Cruas (Ardèche - Région Rhône-Alpes),
chapiteau de forme cubique.
Image 8
A Cruas (Ardèche - Région Rhône-Alpes),
chapiteau de forme cubique.
-

Saint-Paul d'Arnave (Ariège - Midi
Pyrénées).
Image 9
Saint-Paul d'Arnave (Ariège - Midi Pyrénées).
-

San Pedro de la Nave ( Castille-Leon
Espagne) chapiteau wisigothique à forme
trapézoïdale.
Image 10
San Pedro de la Nave ( Castille-Leon Espagne)
chapiteau wisigothique à forme trapézoïdale.
-

A Loupian (Hérault- Languedoc), église
Saint-Hippolyte. Le chapiteau de gauche de
forme trapézoïdale peut être attribué au Ve- VIe
siècle. Les deux autres lui sont sans doute
contemporains.
Image 11
A Loupian (Hérault- Languedoc), église
Saint-Hippolyte. Le chapiteau de gauche de forme
trapézoïdale peut être attribué au Ve- VIe
siècle. Les deux autres lui sont sans doute
contemporains.
-

Chapiteaux déposés au musée lapidaire
Lamourguier de Narbonne (Aude - Languedoc).
Image 12
Chapiteaux déposés au musée lapidaire Lamourguier
de Narbonne (Aude - Languedoc).
-

Chapiteaux du portail de l’église de Bossòst
val d'Aran (Catalogne).
Image 13
Chapiteaux du portail de l’église de
Bossòst val d'Aran (Catalogne).
-

Chapiteau cubique à Brème (Allemagne).
Image 14
Chapiteau cubique à Brème (Allemagne).
-

Chapiteaux de forme « arabisante » au Duomo
de Parme (Italie du Nord). Remarquer que les
colonnes et les chapiteaux doivent être de
remploi.
Image 15
Chapiteaux de forme « arabisante » au Duomo de
Parme (Italie du Nord). Remarquer que les colonnes
et les chapiteaux doivent être de remploi.
-

A Piacenza, église Saint-Savin : autre forme
de chapiteau (le tailloir fait corps avec le
chapiteau). Décor d’entrelacs dits «
carolingiens ».
Image 16
A Piacenza, église Saint-Savin : autre forme de
chapiteau (le tailloir fait corps avec le
chapiteau). Décor d’entrelacs dits « carolingiens
».
-

Église Santa Maria de Porqueres (Banyoles -
Catalogne). Chapiteau de forme « arabisante
». Remarquer la fissure au niveau de la
jonction des deux formes (cylindrique et
parallélépipédique).
Image 17
Église Santa Maria de Porqueres (Banyoles -
Catalogne). Chapiteau de forme « arabisante ».
Remarquer la fissure au niveau de la jonction des
deux formes (cylindrique et parallélépipédique).
-

Autre forme de chapiteau à Toulon-sur-Arroux
(Bourgogne).
Image 18
Autre forme de chapiteau à
Toulon-sur-Arroux (Bourgogne).