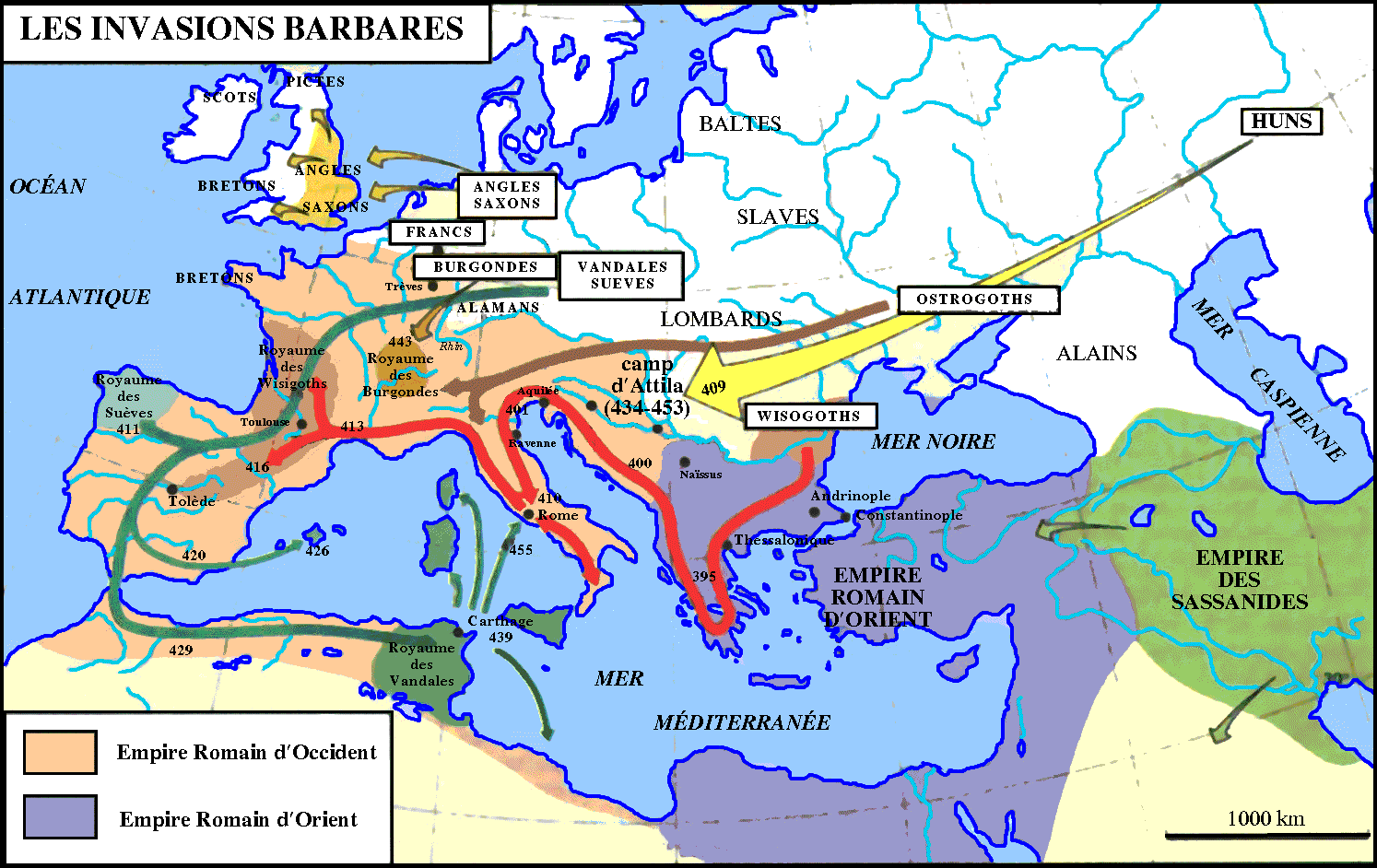Petit inventaire des idées reçues concernant le Premier Millénaire
• Histoire • Article
précédent • Article
suivant
Chacun d’entre nous a deux ascendants n+1, 4 ascendants n+2, 8 ascendants n+3, .. A chaque génération que l’on remonte ainsi, on multiplie par 2 le nombre des ascendants. Et si on admet qu’il y a une génération tous les 25 ans, on en compte 4 par siècle, 8 pour deux siècles, 12 pour trois siècles . Donc pour chacun d’entre nous on peut compter 16 ascendants n+4 ayant vécu cent ans avant nous, 16X16= 256 ascendants n+8 ayant vécu deux cent ans auparavant, 16X256= 4096 ascendants n+ 12 ayant vécu trois cent ans auparavant.
Comme on le voit, on atteint très rapidement des nombres impressionnants. Certes, il faut reconnaître que ces nombres ne reflètent pas la réalité. En effet (les généalogistes le savent fort bien) on peut retrouver le même ancêtre en plusieurs embranchements d’une même généalogie ascendante. Et, par suite, le nombre d’ascendants distincts est diminué. Malgré ce, le nombre des ascendants reste très important. Il serait intéressant d’effectuer une étude mathématique permettant d’évaluer le nombre d’ascendants n+p à la génération (ascendante) p. Car ce nombre doit atteindre une limite. En effet, en supposant que pour toute génération p les ascendants n+p soient tous distincts, on obtiendrait pour l'ensemble de nos ascendants ayant vécu il y a 1000 ans, soit 40 générations avant la nôtre (1000 = 40X25), le nombre de 2 puissance 40, soit 240=2x2...x2 (40 fois). Ce nombre est égal à 1 099 511 627 776. Il est supérieur à celui de l’actuelle population mondiale. Bien sûr ce nombre trop théorique est beaucoup trop important. Néanmoins, on est en droit de penser que pour chacun d’entre nous, le nombre d’ascendants n+40 (c’est à dire ayant vécu à l’an 1000) doit dépasser le million.
Une telle constatation devrait inciter chacun d’entre nous à remettre en question quelques idées ou opinions toutes faites. Ainsi des phrases telles que : « Bon sang ne peut mentir ! », « Je n’aime pas les anglais qui sont nos ennemis héréditaires ! », « Dans ma famille les filles n’épousent pas les noirs ! » deviennent de moins en moins crédibles au fur et à mesure que l’on remonte les siècles. Et, en ce qui me concerne je suis obligé d’admettre que, parmi les millions de mes propres ancêtres issus des générations postérieures à l’an mille, il a dû y avoir des voleurs et des assassins, des prêtres défroqués, des prostituées, des complices des anglais, des noirs, des juifs, des arabes.
En conséquence des affirmations telles que : « Nos ancêtres les Gaulois » ne peuvent être que purement incantatoires. Car elles ne tiennent pas compte des mouvements de migrations qui se sont produites durant 2000 ans. Un exemple : un habitant de Belle-Île en Mer , en Bretagne, né dans cette île et dont tous les aïeuls ont vécu dans cette île dira sans doute que cette île est la « terre de ses ancêtres ». Or ce n’est probablement pas le cas car Belle-Île a accueilli une forte colonie d’acadiens chassés par les anglais au XVIIIesiècle.
Cet événement s’est passé il y a 250 ans. Que peut-on dire alors de tous les événements, ignorés pour la plupart d’entre eux, qui se sont passés depuis 2000 ans ?
Je croyais que Auguste était le nom du premier des empereurs romains.
Je découvre que le nom d’Auguste a été donné à toute une série d’empereurs romains ayant succédé à Auguste. En fait, durant les premiers siècles de notre ère, il n’y a pas eu d’empereur romain mais des augustes. Lorsqu’un général romain (qui, au début est apparenté à la famille d’Auguste) est distingué par le sénat ou les légions romaines on lui donne des qualificatifs comme, par exemple, « pius » (pieux), et on lui associe le nom de « augustus ». Mais il ne semble pas que, au cours des premiers siècles, on ait ajouté à tous les qualificatifs le titre de « imperator » (ceci est à vérifier sur l’ensemble de la documentation y-compris épigraphique). Le qualificatif de « Augustus » serait donc, a priori, plutôt un titre de gloire – le candidat ainsi qualifié devenant ainsi l’égal d’Auguste - qu’une fonction et les pouvoirs qui lui sont associés. Ceci étant on sait que, au cours de sa vie, Auguste s’est arrogé un grand nombre de pouvoirs. Et ce, tout en refusant les titres qui auraient permis à ses contemporains de réaliser qu’il prenait le pouvoir. Il est donc fort possible que le personnage désigné comme « auguste » par ses concitoyens (ne l’appelons pas « empereur » si le mot n’existait pas encore) ait obtenu les mêmes pouvoirs. Pensons aussi que les structures n’étaient pas nécessairement figées et qu'il a pu y avoir une variation des comportements au cours du temps. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé avec la création des « Césars ».
Voir les mots « César » puis «Empereur ».
Je croyais que : Les légions romaines étaient formés de soldats romains.
Je découvre que : Tout d’abord, les soldats romains n’étaient pas tous nés à Rome. Au fur et à mesure de leurs conquêtes, les romains ont intégré dans leurs troupes des éléments des pays auparavant conquis ayant acquis une culture latine.
(Voir dans ce chapitre Histoire la page Les peuples fédérés).
Je croyais que : un barbare est un homme cruel. Un acte dit « de barbarie » est un acte de cruauté. Le barbare est considéré comme un être primaire et inculte. Le barbare n’existe pas comme individu : il ne porte pas de nom.
Je découvre que pour les auteurs anciens, la barbarie caractérise non pas la cruauté, mais l’inculture latine. Pour eux le barbare est celui qui est incapable de parler correctement le latin : le mot « barbare » est issu du bredouillement « ba- ba » ou « bar-bar » ; lequel bredouillement a produit aussi le mot : « borborygme ».
(Voir dans ce chapitre Histoire la page Les peuples fédérés).
Parmi tous les peuples habitant la Gaule à la même époque, en existe-t-il d’autres qui ne sont pas Gaulois ?
(Voir plus loin les mots de Novempopulanie et de Toulouse)
(Voir ci-dessous le mot de Mérovingien)
Je croyais en la certitude des déclarations des historiens ou des archéologues : quand l’un d’entre eux nous mentionne telle ou telle découverte, nous sommes tous enclins à le croire. Ainsi lorsque, il y a quelques années une tête sculptée romaine a été retrouvée à Arles, dans le Rhône, (voir l’image 4), il n’a fait aucun doute pour moi qu’il s’agissait bien d’une représentation de César, comme l’affirmaient les découvreurs. Mais, à la lecture de l’encyclopédie en ligneWikipedia, j’apprends qu’il existe une polémique là-dessus et que d’autres chercheurs affirment qu’il ne s’agit pas d’un portrait de César. Qui a raison ? qui a tort? Le paradoxe dans tout cela c’est que chacun exprime des certitudes alors que, à la base, il n’y a que des opinions basées sur des ressemblances. A titre de comparaison la « preuve par l ‘ADN » pourtant bien plus probante que ces affirmations péremptoires est toujours accompagnée d’une évaluation : « il y a 99% de chances que l’ADN trouvé corresponde à celui de tel individu ». Quel est le pourcentage de chances que la tête d’Arles représente César ?
Je croyais que César était le nom d’un général romain ayant conquis la Gaule.
Je découvre que : César est le prénom de plusieurs empereurs romains ayant succédé à Auguste. (Voir aussi le mot « Auguste »). Il ne s’agit pas des successeurs immédiats. En effet les premiers successeurs d’Auguste ont adopté le prénom de « Auguste » et ont été désignés comme tels : des augustes (et non, si ma lecture est bonne, des empereurs). Plus tard, ces augustes qui avaient pris en charge simultanément les affaires militaires et les affaires civiles se sont aperçu des lourdeurs de leurs tâches : on ne peut pas simultanément être à Rome et suivre les armées au combat. Ils ont donc désigné des « Césars » pour les remplacer sur le terrain militaire. Le « César » a pris de l’importance tout en restant, semble-t-il, subordonné à « l’Auguste ». Ainsi, Suétone a écrit la « Vie des douze Césars » et non la « Vie des douze Augustes », bien que les premiers empereurs qu’il décrit et, en particulier, le premier d’entre eux, Auguste, n’aient jamais eu une fonction de césar.
Le mot de « César » s’est perpétué. Il a donné le titre de « Kaiser » en Allemagne et de « Tsar » en Russie. Il désigne dans ces pays ainsi que dans la totalité des pays germaniques ou slaves ceux que nous appelons « empereur ». A remarquer que toutes les langues latines ont, elles, adopté le mot « empereur ».
(Voir aussi le mot « Empereur »).
Il est admis par tous (hormis par ceux qui connaissent la relativité restreinte) que le temps ne se comprime pas. Et pourtant, en ce qui concerne les événements historiques, nous avons tous tendance à effectuer une telle compression du temps.
Comme chacun sait, la mode actuelle est à la reconstitution d’évènements historiques. Imaginons que l’on décide de reconstituer la bataille d’Austerlitz, mais que l’on manque d’uniformes de soldats prussiens. Et que l’organisateur décide de remplacer ces uniformes par ceux de soldats allemands de la seconde guerre mondiale. Ou par ceux de soldats anglais de la bataille d’Azincourt. Que penserait-on de tout cela ? Très certainement on en rirait. Ou on en serait indignés voyant dans cet acte une intention malveillante.
Eh bien ! c’est exactement ce qui se passe concernant le Premier Millénaire : romains, wisigoths, francs, mérovingiens, normands, arabes, sont allègrement mélangés. Et il semble évident, même pour les esprits les plus brillants, que la prise de Rome par Alaric vers l’an 410 a provoqué le néant de l’Europe durant plus de 600 ans. Tout se passe comme si le temps s’était totalement compressé durant cette période.
Je croyais que la religion catholique a beaucoup évolué durant les siècles et que, primitivement, cette religion était fortement imprégnée de superstitions.
Je découvre que Grégoire de Tours introduit son « Histoire des Francs » par une profession de foi dont voici le début : « Je crois donc en Dieu pur tout-puissant ; je crois en Jésus-Christ son fils unique, notre Seigneur Dieu, né du Père et non créé ; je crois qu'il a toujours été avec le père, non depuis un temps, mais avant tous les temps ;… ». Cette profession de foi fait immédiatement penser au Crédo récité actuellement par tous les fidèles catholiques durant la célébration eucharistique. Ce texte est celui du « Crédo de Nicée » ; De nos jours ce Credo fait plutôt figure de prière à caractère incantatoire. En effet fort peu de fidèles qui récitent ce Crédo le comprennent dans son intégralité ou adhèrent réellement à la totalité de cet acte de foi. Il devait en être de même au VIesiècle Et il est curieux de déceler le même caractère incantatoire chez un auteur ayant vécu 1400 ans avant nous.
J’en déduis qu’l y a eu rigidité sur les questions doctrinales au sein de l’église catholique. Cette rigidité est manifeste dans l’œuvre de Grégoire de Tours. Celui-ci, en effet, est intransigeant sur ces questions lorsqu’il dialogue avec les hérétiques ou les juifs. Par contre il semble plus modéré en ce qui concerne les mœurs de certains de ses collègues. Malgré son intransigeance, il demeure tolérant vis-à-vis des hérétiques, et s’il condamne fermement leurs idées, il ne les condamne pas comme hommes et les laisse partir libres. Par contre, on sent que ces questions le passionnent et il passe beaucoup de temps à argumenter.
Grégoire de Tours constitue peut être une exception. Néanmoins on découvre au travers de son activité une religion beaucoup plus intellectualisée que l’on pouvait penser. Et aussi beaucoup moins imprégnée de superstitions. Il existe, bien sûr, des témoignages de miracles effectués par des saints. Mais ces témoignages sont beaucoup moins fantaisistes que ceux des siècles suivants. Beaucoup plus explicables rationnellement.
Je croyais que les Romains avaient colonisé la Gaule et beaucoup d’autres régions de l’Empire.
Je découvre que, dans les faits, les régions dites colonisées couvrent seulement une partie du territoire de l’empire romain. Pour d’autres parties la présence romaine est réduite.
(Voir à ce sujet dans ce chapitre Histoire les pages Gaule et Gaulois et Rome et Romains).
Avant d’effectuer cette étude, je croyais que la plupart des dédicaces d’églises romanes remontaient à une date relativement récente, aux XIeou XIIesiècle. Par ailleurs, je pensais que les plus anciennes églises avaient être dédiées à Saint-Martin ou à Saint-Michel (elles semblaient plus anciennes) et qu’elles avaient été dédicacées vers le
VIIIeou IXesiècle. La dédicace des autres devait être plus récente. Pour moi, l’étude des dédicaces d’églises devait me permettre d’effectuer une datation de leur première construction par comparaison avec les dédicaces d’autres églises. Restait cependant à trouver un témoignage écrit de ces dédicaces.
Je découvre à présente que ce témoignage existait ! C’était l’œuvre de Grégoire de Tours! Ce n’est certes pas un témoignage exhaustif permettant de dater l’ensemble des églises de France. Mais l’œuvre de Grégoire de Tours peut servir de référence. Et elle permet d ‘établir que les églises ont été dédicacées bien avant le VIesiècle, époque durant laquelle a vécu Grégoire de Tours.
La datation par les dédicaces demeure néanmoins délicate car ces dédicaces ont pu avoir été changées au cours du temps..
Je croyais que les mots « empire » et « république » étaient antinomiques. Qu’il était impossible de réconcilier l’empire et la république. Nous avons une vision héritée des luttes politiques du XIXesiècle. Ce que nous appelons république est, en fait, la démocratie. C’est une forme de gouvernement par une assemblée élue par l’ensemble des citoyens. L’empire est une autre forme de gouvernement exercé par un des citoyens qui s’est distingué des autres par ses qualités exceptionnelles.
Je découvre que dans les textes de Suétone ou de l’Histoire d'Auguste le mot « d’empereur » n’apparaît pas. Mais c’est celui « d’auguste » ou de « césar » qui permet de définir tous ceux que l’on appelle à présent des « empereurs ». Cependant, même si ce mot n’apparaît pas, on peut penser que la fonction est la même et continuer à appeler « empire » la forme de gouvernement exercée par un « auguste » ou un « césar ».
Si le mot « empire » n’apparaît pas dans les textes anciens, par contre le mot « république » y est bien. Et pour des époques tardives du IIeou IIIesiècle pour lesquelles on était sûr que l’empire était solidement installé. La surprise est de taille ! On croyait être au beau milieu de l’empire et on se trouve en pleine république! D’autant plus lorsqu’on qu’on apprend qu’un des empereurs invitait ses successeurs à respecter le Sénat et ses décisions. Comment donc ? Il existait encore un Sénat ? Quant aux sénateurs, on découvre qu’il en existait encore à Tours au VIesiècle de notre ère.
J’en déduis que nous avons pu être influencés par l’image classique des péplums montrant un empereur tout puissant réglant les affaires de l’empire. Et que la réalité pouvait être toute autre.
Je croyais que, durant le haut Moyen-Âge, les évêques n’avaient aucune importance politique.
Je découvre à la lecture de « L’Histoire des Francs » que, outre leur pouvoir spirituel primordial, les évêques avaient une grande importance sur le plan temporel, non seulement au niveau de leurs richesses personnelles et celles de leurs évêchés, mais aussi de l’influence qu’ils développaient auprès des princes et des rois.
Il apparaît à la lecture des textes que les évêques ont pu avoir un rôle encore plus important que Richelieu ou Mazarin qui étaient de simples conseillers de rois de France. Ainsi, le pouvoir de Grégoire de Tours semble s’étendre à toute la Touraine. Grégoire dialogue directement avec le roi de France. Lequel est installé dans des villes comme Paris ou Soissons. Et il ne semble pas que dans la ville même de Tours, Grégoire reçoive des ordres d’un quelconque émissaire du roi de France. Pas plus d’ailleurs que de l’Empereur de Byzance .. ou de l’Evêque de Rome.
Avant de lire les historiens latins, j’ignorais l’importance de ce mot, ou du moins je ne l’avais pas réalisée à la lecture des historiens récents.
Je découvre que , outre des auxiliaires (voir ce mot), barbares enrôlés dans leurs légions, les romains avaient recours à des peuples fédérés. C’est-à-dire des peuples barbares ayant conclu une sorte de contrat d’alliance avec les romains.
(Voir dans ce chapitre Histoire la page Les peuples fédérés).
(Voir dans ce chapitre Histoire la page Histoire des Goths 1).
Je croyais que l’histoire de Rome commençait par une période d’extension et de grandeur jusqu’au IIesiècle. A partir de la fin du IIesiècle, un déclin s’amorce : c’est la décadence. On obtient un schéma grossi de cette évolution en présentant une courbe sous forme de cloche présentant une croissance continue avant le milieu du IIesiècle et une décroissance aussi continue après.
Je découvre que la réalité n’est pas aussi simple que cela. Tout d’abord et avant même d’avoir commencé la lecture des auteurs de l’antiquité, le livre d’Henri-Irénée Marrou, « Décadence romaine ou antiquité tardive ? » m’a fait remettre en question la notion même de «décadence ». En effet, l’auteur fait apparaître que l’antiquité tardive est plus une période de renouvellement que de déclin. L’auteur ne nie pas toutefois qu’il ait pu y avoir déclin ou perte de certaines connaissances. Mais il insiste sur le fait que cette période est une période de mutation.
Par ailleurs un archéologue, Elian Gomez, m’a appris que, au moins pour la région qu’il connaissait le mieux, le Biterrois, les périodes de richesse et de pauvreté pouvaient être différentes de celles définies pour la « grandeur » et pour la « décadence ». Le mobilier céramique qu’il avait recueilli dans une strate identifiée en pleine période de »grandeur » pouvait se révéler de qualité bien inférieure à celui d’une autre strate appartenant à une période dite de « décadence ». Une telle information remettait fondamentalement en cause l’idée d’une croissance continue avant le IIesiècle suivie d’une décroissance tout aussi continue après.
La lecture des auteurs antiques a confirmé ces analyses. Et actuellement une réflexion portant sur de nombreux points, est engagée afin de vérifier s’il y a eu décadence ou mutation. Les pages suivantes de ce chapitre « Histoire » vont témoigner de cette réflexion.
Que signifie le mot invasion ? Le petit Larousse nous donne pour définition de ce mot, « l’action d’envahir un pays avec des troupes armées ». Mais il ne précise pas que cette action d’envahir un pays est à sens unique. Mon pays, la France, a été envahi dans le passé, mais n’a jamais envahi un autre pays. Ainsi la petite promenade que Napoléon a fait faire à la Grande Armée en 1813 est appelée « Campagne de Russie » et non « Invasion de la Russie » Et de même le mot « invasion » n’est pas utilisé concernant nos guerres coloniales. On lui préfère les mots « envoi de troupes » ou « soutien à tel roitelet » En conséquence, le mot « invasion » n’est pas tout à fait neutre. Et si on tient à l’employer, il faut équilibrer les deux camps. C’est-à-dire se poser la question : s’il y a eu invasion de l’empire romain par des peuples barbares, l’inverse s’est-il produit aussi, invasion des pays barbares par les romains ?
J’ai découvert récemment sur Wikipedia qu’il y avait, sur ce sujet, débat entre historiens français et allemands, les premiers gardant le mot, « invasions barbares », les seconds préférant le mot, « migrations de peuples ».
A l’heure actuelle mon opinion est que, quelque soit le mot adopté, il y a eu exagération des effets de ces « invasions » ou de ces « migrations ».
(Voir la page « Qui est le plus grand spécialiste des Mérovingiens ?).
Voir ci-dessus le mot de Mérovingien. Il y a cependant une grande différence car le mot « Ottonien » ne s’applique pas à un peuple mais à une dynastie d’empereurs d’Allemagne désignés sous le nom de « Othon ». Et comme ces empereurs ont entrepris la construction d’une série de cathédrales, on qualifie d’ottoniennes celles-ci ainsi que d’autres églises analogues.
Je croyais que la persécution des Chrétiens s’était déroulée durant les débuts de l’ère chrétienne jusqu’aux environs de l’an 300.
Je découvre que les textes historiques (laïcs) sont très silencieux sur tout ce qui concerne les chrétiens des premiers siècles. On en parle au premier siècle (surtout en mal). Et puis, presque plus rien pour les siècles suivants. Le paradoxe vient du fait qu’on en parle aussi très peu après le règne de Constantin durant environ un siècle. Comme si les chrétiens n’avaient jamais existé. Ou plutôt comme si cette période avait laissé un si mauvais souvenir qu’il était préférable de ne pas en parler. On découvre aussi (ou plutôt on devine) que, durant les trois premiers siècles, les persécutions n’ont pas été constantes et d’égale intensité. Il y a eu des périodes de calme relatif durant lesquelles le christianisme s’est redressé et fortifié. Mais ces périodes de calme n’expliquent pas le silence postérieur à la décennie 330. On sait qu’il y a eu des divisions profondes entre les chrétiens qui avaient renié leur foi et ceux qui n’avaient pas cédé (hérésie donatiste). On devine aussi que la réforme de Constantin a dû s’accompagner de vengeances vis-à-vis des persécuteurs des chrétiens.
J’en déduis que l’histoire des persécutions des chrétiens ne s’est très probablement pas arrêtée à l’avènement de Constantin. Ces persécutions ont dû laisser des séquelles durables et pendant longtemps il a dû être dangereux d’afficher publiquement sa foi, que l’on soit chrétien ou que l’on soit païen. Il faut aussi noter que la fin (officielle) des persécutions correspond à une montée en puissance des hérésies (le donatisme déjà cité, le priscillianisme, l’arianisme) et à une disparition du paganisme. Il est possible que les descendants des païens qui avaient persécuté les chrétiens, devenus interdits de religion aient opté pour l’une ou l’autre des hérésies afin de s’opposer au catholicisme (on devrait plutôt parler d’orthodoxie) triomphant. Dans tous les cas, il faudra effectuer une analyse précise afin d’estimer les époques de persécutions probables et l’intensité de ces persécutions, les époques de calme relatif, les temps de conflits entre chrétiens et autres religions, entre catholiques orthodoxes et hérétiques.
Je croyais que la religion des romains était unique et inamovible au cours des temps. Qu’il y avait de plus une religion « impériale » ; c’est-à-dire que l’empereur était considéré comme un dieu.
Je découvre que la réalité est apparemment plus complexe. Au fur et à mesure de leurs conquêtes les romains auraient intégré des dieux locaux en leur donnant le nom de leurs propres dieux. Sans toutefois pouvoir leur donner les attributs de leurs dieux ou les mythes qui leur étaient associés. Si bien que, pour le même nom de dieu, on peut avoir plusieurs légendes ou plusieurs attributs. A remarquer qu’on à la même chose au niveau des saints chrétiens : le même saint peut être vénéré dans plusieurs endroits différents avec plusieurs vies différentes (par exemple Saint-Nicolas). Cette religion romaine (on devrait plutôt dire : ces religions romaines) a (ont) beaucoup évolué au cours du temps. Il y a eu d’abord une période d’intégration des religions étrangères. Il est probable que ces religions qui avaient adopté pour leurs dieux des noms de dieux romains ont fait évoluer la religion romaine. Puis, lorsque l’empire a commencé à décliner les peuples colonisés par les romains ont repris leurs anciens dieux. Quant aux romains (ou les élites des peuples colonisés), leurs croyances ont évolué. On constate en effet que les romains attachent plus d’importance aux obsèques. Les sépultures sont plus riches qu’auparavant et les thèmes d’ornementation développent l’idée d’une existence après la mort. Il y a aussi l’importance donnée aux religions orientales. Le christianisme, bien sûr, mais aussi le judaïsme, les cultes d’Isis, de Cybèle, de Mithra, le mazdéisme. Toutes religions qui invitent à croire en un Dieu unique. En règle générale, l’empereur n’est pas considéré comme un Dieu mais comme « pieux ». Il semblerait que la vénération qu’on lui devait était comparable à celle, actuelle, des catholiques pour leur pape.
(Voir ci-dessus à Empire Romain).
Je croyais que les Saints n’ont pas existé ! Oh bien sûr j’exagère un peu en disant cela. A la différence de certains historiens du XIXesiècle qui ont affirmé que l’homme Jésus était une pure invention, j’étais bien persuadé de l’existence de Jésus-Homme, et, avec lui, de ses apôtres. J’étais aussi convaincu de l’existence de saints ayant vécu à une époque plus proche de la nôtre comme saint Pie X , Saint François d’Assise ou Saint Bernard de Clairvaux. Mais entre ces deux groupes de saints dont l’existence est hautement probable, il y avait une foule de saints dont la légitimité me semblait douteuse. Prenons le cas de Saint Aphrodise, premier évêque de Béziers. Les légendes attachées à ce saint étaient tellement extraordinaires que son existence pouvait être remise en cause. Et ce, d’autant plus que le premier texte le mentionnant était postérieur de près de cinq siècles à son supposé martyre. Pour moi donc, l’existence d’un grand nombre de saints locaux devait être remise en cause. Leurs légendes étaient pour moi les résultats d’une invention purement artificielle au cours du premier millénaire.
Aïeul
–
Ancêtre – Ascendant
- Tout d’abord quelques définitions :
l’ascendant d’un individu est un parent dont l’individu en
question descend en ligne directe. L’aïeul est un
grand-parent (grand-père ou grand-mère). Le bisaïeul est
un arrière-grand-parent (père ou mère d’un aïeul). Le
trisaïeul, un arrière-arrière-grand-parent (père ou mère
d’un bisaïeul). On désigne en général par ancêtre un
ascendant d’une génération plus ancienne que celle de
l’aïeul.
Il existe plusieurs idées reçues concernant les ascendants. Il y a tout d‘abord une confusion entre les mots « aïeux » et « ancêtres ». Ainsi « la terre de nos ancêtres » est souvent appelée « la terre de nos aïeux ». Or on vient de voir que les deux ensembles d’individus (aïeux et ancêtres) sont bien distincts.
Mais la principale des idées reçues nait de cette confusion. Car nous avons tendance à nous représenter nos ancêtres à l’image de nos aïeux.
Chacun d’entre nous a deux ascendants n+1, 4 ascendants n+2, 8 ascendants n+3, .. A chaque génération que l’on remonte ainsi, on multiplie par 2 le nombre des ascendants. Et si on admet qu’il y a une génération tous les 25 ans, on en compte 4 par siècle, 8 pour deux siècles, 12 pour trois siècles . Donc pour chacun d’entre nous on peut compter 16 ascendants n+4 ayant vécu cent ans avant nous, 16X16= 256 ascendants n+8 ayant vécu deux cent ans auparavant, 16X256= 4096 ascendants n+ 12 ayant vécu trois cent ans auparavant.
Comme on le voit, on atteint très rapidement des nombres impressionnants. Certes, il faut reconnaître que ces nombres ne reflètent pas la réalité. En effet (les généalogistes le savent fort bien) on peut retrouver le même ancêtre en plusieurs embranchements d’une même généalogie ascendante. Et, par suite, le nombre d’ascendants distincts est diminué. Malgré ce, le nombre des ascendants reste très important. Il serait intéressant d’effectuer une étude mathématique permettant d’évaluer le nombre d’ascendants n+p à la génération (ascendante) p. Car ce nombre doit atteindre une limite. En effet, en supposant que pour toute génération p les ascendants n+p soient tous distincts, on obtiendrait pour l'ensemble de nos ascendants ayant vécu il y a 1000 ans, soit 40 générations avant la nôtre (1000 = 40X25), le nombre de 2 puissance 40, soit 240=2x2...x2 (40 fois). Ce nombre est égal à 1 099 511 627 776. Il est supérieur à celui de l’actuelle population mondiale. Bien sûr ce nombre trop théorique est beaucoup trop important. Néanmoins, on est en droit de penser que pour chacun d’entre nous, le nombre d’ascendants n+40 (c’est à dire ayant vécu à l’an 1000) doit dépasser le million.
Une telle constatation devrait inciter chacun d’entre nous à remettre en question quelques idées ou opinions toutes faites. Ainsi des phrases telles que : « Bon sang ne peut mentir ! », « Je n’aime pas les anglais qui sont nos ennemis héréditaires ! », « Dans ma famille les filles n’épousent pas les noirs ! » deviennent de moins en moins crédibles au fur et à mesure que l’on remonte les siècles. Et, en ce qui me concerne je suis obligé d’admettre que, parmi les millions de mes propres ancêtres issus des générations postérieures à l’an mille, il a dû y avoir des voleurs et des assassins, des prêtres défroqués, des prostituées, des complices des anglais, des noirs, des juifs, des arabes.
En conséquence des affirmations telles que : « Nos ancêtres les Gaulois » ne peuvent être que purement incantatoires. Car elles ne tiennent pas compte des mouvements de migrations qui se sont produites durant 2000 ans. Un exemple : un habitant de Belle-Île en Mer , en Bretagne, né dans cette île et dont tous les aïeuls ont vécu dans cette île dira sans doute que cette île est la « terre de ses ancêtres ». Or ce n’est probablement pas le cas car Belle-Île a accueilli une forte colonie d’acadiens chassés par les anglais au XVIIIesiècle.
Cet événement s’est passé il y a 250 ans. Que peut-on dire alors de tous les événements, ignorés pour la plupart d’entre eux, qui se sont passés depuis 2000 ans ?
Je croyais que Auguste était le nom du premier des empereurs romains.
Je découvre que le nom d’Auguste a été donné à toute une série d’empereurs romains ayant succédé à Auguste. En fait, durant les premiers siècles de notre ère, il n’y a pas eu d’empereur romain mais des augustes. Lorsqu’un général romain (qui, au début est apparenté à la famille d’Auguste) est distingué par le sénat ou les légions romaines on lui donne des qualificatifs comme, par exemple, « pius » (pieux), et on lui associe le nom de « augustus ». Mais il ne semble pas que, au cours des premiers siècles, on ait ajouté à tous les qualificatifs le titre de « imperator » (ceci est à vérifier sur l’ensemble de la documentation y-compris épigraphique). Le qualificatif de « Augustus » serait donc, a priori, plutôt un titre de gloire – le candidat ainsi qualifié devenant ainsi l’égal d’Auguste - qu’une fonction et les pouvoirs qui lui sont associés. Ceci étant on sait que, au cours de sa vie, Auguste s’est arrogé un grand nombre de pouvoirs. Et ce, tout en refusant les titres qui auraient permis à ses contemporains de réaliser qu’il prenait le pouvoir. Il est donc fort possible que le personnage désigné comme « auguste » par ses concitoyens (ne l’appelons pas « empereur » si le mot n’existait pas encore) ait obtenu les mêmes pouvoirs. Pensons aussi que les structures n’étaient pas nécessairement figées et qu'il a pu y avoir une variation des comportements au cours du temps. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé avec la création des « Césars ».
Voir les mots « César » puis «Empereur ».
Je croyais que : Les légions romaines étaient formés de soldats romains.
Je découvre que : Tout d’abord, les soldats romains n’étaient pas tous nés à Rome. Au fur et à mesure de leurs conquêtes, les romains ont intégré dans leurs troupes des éléments des pays auparavant conquis ayant acquis une culture latine.
(Voir dans ce chapitre Histoire la page Les peuples fédérés).
Je croyais que : un barbare est un homme cruel. Un acte dit « de barbarie » est un acte de cruauté. Le barbare est considéré comme un être primaire et inculte. Le barbare n’existe pas comme individu : il ne porte pas de nom.
Je découvre que pour les auteurs anciens, la barbarie caractérise non pas la cruauté, mais l’inculture latine. Pour eux le barbare est celui qui est incapable de parler correctement le latin : le mot « barbare » est issu du bredouillement « ba- ba » ou « bar-bar » ; lequel bredouillement a produit aussi le mot : « borborygme ».
(Voir dans ce chapitre Histoire la page Les peuples fédérés).
- Actuellement les Basques forment une
communauté (certains diront un peuple) partagé entre le
Nord de l’Espagne et le Sud de la France de part et
d’autre des Pyrénées (image
5).
Ils ont conservé une culture qui leur est propre et distincte des cultures voisines, caractérisée par des traditions concernant le jeu (pelote basque), le chant, le costume, l’habitat, la structure familiale.
Mais ce qui caractérise surtout le peuple basque, c’est sa langue. Une langue qui n’a aucun rapport avec les dialectes européens et qui serait la survivance d’une langue parlée par les occupants primitifs de la région avant la venue d’envahisseurs indo-européens.
Parmi tous les peuples habitant la Gaule à la même époque, en existe-t-il d’autres qui ne sont pas Gaulois ?
(Voir plus loin les mots de Novempopulanie et de Toulouse)
(Voir ci-dessous le mot de Mérovingien)
Je croyais en la certitude des déclarations des historiens ou des archéologues : quand l’un d’entre eux nous mentionne telle ou telle découverte, nous sommes tous enclins à le croire. Ainsi lorsque, il y a quelques années une tête sculptée romaine a été retrouvée à Arles, dans le Rhône, (voir l’image 4), il n’a fait aucun doute pour moi qu’il s’agissait bien d’une représentation de César, comme l’affirmaient les découvreurs. Mais, à la lecture de l’encyclopédie en ligneWikipedia, j’apprends qu’il existe une polémique là-dessus et que d’autres chercheurs affirment qu’il ne s’agit pas d’un portrait de César. Qui a raison ? qui a tort? Le paradoxe dans tout cela c’est que chacun exprime des certitudes alors que, à la base, il n’y a que des opinions basées sur des ressemblances. A titre de comparaison la « preuve par l ‘ADN » pourtant bien plus probante que ces affirmations péremptoires est toujours accompagnée d’une évaluation : « il y a 99% de chances que l’ADN trouvé corresponde à celui de tel individu ». Quel est le pourcentage de chances que la tête d’Arles représente César ?
Je croyais que César était le nom d’un général romain ayant conquis la Gaule.
Je découvre que : César est le prénom de plusieurs empereurs romains ayant succédé à Auguste. (Voir aussi le mot « Auguste »). Il ne s’agit pas des successeurs immédiats. En effet les premiers successeurs d’Auguste ont adopté le prénom de « Auguste » et ont été désignés comme tels : des augustes (et non, si ma lecture est bonne, des empereurs). Plus tard, ces augustes qui avaient pris en charge simultanément les affaires militaires et les affaires civiles se sont aperçu des lourdeurs de leurs tâches : on ne peut pas simultanément être à Rome et suivre les armées au combat. Ils ont donc désigné des « Césars » pour les remplacer sur le terrain militaire. Le « César » a pris de l’importance tout en restant, semble-t-il, subordonné à « l’Auguste ». Ainsi, Suétone a écrit la « Vie des douze Césars » et non la « Vie des douze Augustes », bien que les premiers empereurs qu’il décrit et, en particulier, le premier d’entre eux, Auguste, n’aient jamais eu une fonction de césar.
Le mot de « César » s’est perpétué. Il a donné le titre de « Kaiser » en Allemagne et de « Tsar » en Russie. Il désigne dans ces pays ainsi que dans la totalité des pays germaniques ou slaves ceux que nous appelons « empereur ». A remarquer que toutes les langues latines ont, elles, adopté le mot « empereur ».
(Voir aussi le mot « Empereur »).
Il est admis par tous (hormis par ceux qui connaissent la relativité restreinte) que le temps ne se comprime pas. Et pourtant, en ce qui concerne les événements historiques, nous avons tous tendance à effectuer une telle compression du temps.
Comme chacun sait, la mode actuelle est à la reconstitution d’évènements historiques. Imaginons que l’on décide de reconstituer la bataille d’Austerlitz, mais que l’on manque d’uniformes de soldats prussiens. Et que l’organisateur décide de remplacer ces uniformes par ceux de soldats allemands de la seconde guerre mondiale. Ou par ceux de soldats anglais de la bataille d’Azincourt. Que penserait-on de tout cela ? Très certainement on en rirait. Ou on en serait indignés voyant dans cet acte une intention malveillante.
Eh bien ! c’est exactement ce qui se passe concernant le Premier Millénaire : romains, wisigoths, francs, mérovingiens, normands, arabes, sont allègrement mélangés. Et il semble évident, même pour les esprits les plus brillants, que la prise de Rome par Alaric vers l’an 410 a provoqué le néant de l’Europe durant plus de 600 ans. Tout se passe comme si le temps s’était totalement compressé durant cette période.
Je croyais que la religion catholique a beaucoup évolué durant les siècles et que, primitivement, cette religion était fortement imprégnée de superstitions.
Je découvre que Grégoire de Tours introduit son « Histoire des Francs » par une profession de foi dont voici le début : « Je crois donc en Dieu pur tout-puissant ; je crois en Jésus-Christ son fils unique, notre Seigneur Dieu, né du Père et non créé ; je crois qu'il a toujours été avec le père, non depuis un temps, mais avant tous les temps ;… ». Cette profession de foi fait immédiatement penser au Crédo récité actuellement par tous les fidèles catholiques durant la célébration eucharistique. Ce texte est celui du « Crédo de Nicée » ; De nos jours ce Credo fait plutôt figure de prière à caractère incantatoire. En effet fort peu de fidèles qui récitent ce Crédo le comprennent dans son intégralité ou adhèrent réellement à la totalité de cet acte de foi. Il devait en être de même au VIesiècle Et il est curieux de déceler le même caractère incantatoire chez un auteur ayant vécu 1400 ans avant nous.
J’en déduis qu’l y a eu rigidité sur les questions doctrinales au sein de l’église catholique. Cette rigidité est manifeste dans l’œuvre de Grégoire de Tours. Celui-ci, en effet, est intransigeant sur ces questions lorsqu’il dialogue avec les hérétiques ou les juifs. Par contre il semble plus modéré en ce qui concerne les mœurs de certains de ses collègues. Malgré son intransigeance, il demeure tolérant vis-à-vis des hérétiques, et s’il condamne fermement leurs idées, il ne les condamne pas comme hommes et les laisse partir libres. Par contre, on sent que ces questions le passionnent et il passe beaucoup de temps à argumenter.
Grégoire de Tours constitue peut être une exception. Néanmoins on découvre au travers de son activité une religion beaucoup plus intellectualisée que l’on pouvait penser. Et aussi beaucoup moins imprégnée de superstitions. Il existe, bien sûr, des témoignages de miracles effectués par des saints. Mais ces témoignages sont beaucoup moins fantaisistes que ceux des siècles suivants. Beaucoup plus explicables rationnellement.
Je croyais que les Romains avaient colonisé la Gaule et beaucoup d’autres régions de l’Empire.
Je découvre que, dans les faits, les régions dites colonisées couvrent seulement une partie du territoire de l’empire romain. Pour d’autres parties la présence romaine est réduite.
(Voir à ce sujet dans ce chapitre Histoire les pages Gaule et Gaulois et Rome et Romains).
- Je savais que la partie de Dacie située
au nord du Danube dans l’actuelle Roumanie a été
abandonnée par les romains vers 270 de notre ère. C’est
d’ailleurs la seule cession de territoire effectuée par
les romains connue par les textes. Logiquement l’autre
partie de Dacie a dû aussi être abandonnée peu après.
Je découvre que les Roumains qui occupent l’ancienne Dacie parlent une langue dérivée du latin. Or les autres peuples dits latins sont restés sous influence romaine bien après le IIIesiècle. D’où la question : comment se fait-il que les Daces, a priori détachés très tôt de cette influence romaine, aient conservé l’usage du latin ? Qui plus est, c’est le seul peuple qui, actuellement encore, porte le nom de « Romain » .
Avant d’effectuer cette étude, je croyais que la plupart des dédicaces d’églises romanes remontaient à une date relativement récente, aux XIeou XIIesiècle. Par ailleurs, je pensais que les plus anciennes églises avaient être dédiées à Saint-Martin ou à Saint-Michel (elles semblaient plus anciennes) et qu’elles avaient été dédicacées vers le
VIIIeou IXesiècle. La dédicace des autres devait être plus récente. Pour moi, l’étude des dédicaces d’églises devait me permettre d’effectuer une datation de leur première construction par comparaison avec les dédicaces d’autres églises. Restait cependant à trouver un témoignage écrit de ces dédicaces.
Je découvre à présente que ce témoignage existait ! C’était l’œuvre de Grégoire de Tours! Ce n’est certes pas un témoignage exhaustif permettant de dater l’ensemble des églises de France. Mais l’œuvre de Grégoire de Tours peut servir de référence. Et elle permet d ‘établir que les églises ont été dédicacées bien avant le VIesiècle, époque durant laquelle a vécu Grégoire de Tours.
La datation par les dédicaces demeure néanmoins délicate car ces dédicaces ont pu avoir été changées au cours du temps..
Je croyais que les mots « empire » et « république » étaient antinomiques. Qu’il était impossible de réconcilier l’empire et la république. Nous avons une vision héritée des luttes politiques du XIXesiècle. Ce que nous appelons république est, en fait, la démocratie. C’est une forme de gouvernement par une assemblée élue par l’ensemble des citoyens. L’empire est une autre forme de gouvernement exercé par un des citoyens qui s’est distingué des autres par ses qualités exceptionnelles.
Je découvre que dans les textes de Suétone ou de l’Histoire d'Auguste le mot « d’empereur » n’apparaît pas. Mais c’est celui « d’auguste » ou de « césar » qui permet de définir tous ceux que l’on appelle à présent des « empereurs ». Cependant, même si ce mot n’apparaît pas, on peut penser que la fonction est la même et continuer à appeler « empire » la forme de gouvernement exercée par un « auguste » ou un « césar ».
Si le mot « empire » n’apparaît pas dans les textes anciens, par contre le mot « république » y est bien. Et pour des époques tardives du IIeou IIIesiècle pour lesquelles on était sûr que l’empire était solidement installé. La surprise est de taille ! On croyait être au beau milieu de l’empire et on se trouve en pleine république! D’autant plus lorsqu’on qu’on apprend qu’un des empereurs invitait ses successeurs à respecter le Sénat et ses décisions. Comment donc ? Il existait encore un Sénat ? Quant aux sénateurs, on découvre qu’il en existait encore à Tours au VIesiècle de notre ère.
J’en déduis que nous avons pu être influencés par l’image classique des péplums montrant un empereur tout puissant réglant les affaires de l’empire. Et que la réalité pouvait être toute autre.
Je croyais que, durant le haut Moyen-Âge, les évêques n’avaient aucune importance politique.
Je découvre à la lecture de « L’Histoire des Francs » que, outre leur pouvoir spirituel primordial, les évêques avaient une grande importance sur le plan temporel, non seulement au niveau de leurs richesses personnelles et celles de leurs évêchés, mais aussi de l’influence qu’ils développaient auprès des princes et des rois.
Il apparaît à la lecture des textes que les évêques ont pu avoir un rôle encore plus important que Richelieu ou Mazarin qui étaient de simples conseillers de rois de France. Ainsi, le pouvoir de Grégoire de Tours semble s’étendre à toute la Touraine. Grégoire dialogue directement avec le roi de France. Lequel est installé dans des villes comme Paris ou Soissons. Et il ne semble pas que dans la ville même de Tours, Grégoire reçoive des ordres d’un quelconque émissaire du roi de France. Pas plus d’ailleurs que de l’Empereur de Byzance .. ou de l’Evêque de Rome.
Avant de lire les historiens latins, j’ignorais l’importance de ce mot, ou du moins je ne l’avais pas réalisée à la lecture des historiens récents.
Je découvre que , outre des auxiliaires (voir ce mot), barbares enrôlés dans leurs légions, les romains avaient recours à des peuples fédérés. C’est-à-dire des peuples barbares ayant conclu une sorte de contrat d’alliance avec les romains.
(Voir dans ce chapitre Histoire la page Les peuples fédérés).
- Je croyais que les Francs, comme les
Gaulois avant eux, étaient les ancêtres des français.
Je découvre que la réalité est moins simple.
A la fin du VIesiècle, bien après que Clovis ait chassé les Wisigoths, les Francs n’occupent pas la totalité de l’actuelle France. Des zones entières comme Toulouse et le Bas-Languedoc, la Provence, les Alpes, l’Armorique, ne sont pas soumises aux Francs.
La Bourgogne (dépendant des Burgondes) est en cours d'annexion. Par contre, les régions de Belgique et de Rhénanie sont sous dépendance de tribus franques qui peuvent être différentes de celles occupant la France.
(Voir dans ce chapitre Histoire la page Histoire des Goths 1).
Je croyais que l’histoire de Rome commençait par une période d’extension et de grandeur jusqu’au IIesiècle. A partir de la fin du IIesiècle, un déclin s’amorce : c’est la décadence. On obtient un schéma grossi de cette évolution en présentant une courbe sous forme de cloche présentant une croissance continue avant le milieu du IIesiècle et une décroissance aussi continue après.
Je découvre que la réalité n’est pas aussi simple que cela. Tout d’abord et avant même d’avoir commencé la lecture des auteurs de l’antiquité, le livre d’Henri-Irénée Marrou, « Décadence romaine ou antiquité tardive ? » m’a fait remettre en question la notion même de «décadence ». En effet, l’auteur fait apparaître que l’antiquité tardive est plus une période de renouvellement que de déclin. L’auteur ne nie pas toutefois qu’il ait pu y avoir déclin ou perte de certaines connaissances. Mais il insiste sur le fait que cette période est une période de mutation.
Par ailleurs un archéologue, Elian Gomez, m’a appris que, au moins pour la région qu’il connaissait le mieux, le Biterrois, les périodes de richesse et de pauvreté pouvaient être différentes de celles définies pour la « grandeur » et pour la « décadence ». Le mobilier céramique qu’il avait recueilli dans une strate identifiée en pleine période de »grandeur » pouvait se révéler de qualité bien inférieure à celui d’une autre strate appartenant à une période dite de « décadence ». Une telle information remettait fondamentalement en cause l’idée d’une croissance continue avant le IIesiècle suivie d’une décroissance tout aussi continue après.
La lecture des auteurs antiques a confirmé ces analyses. Et actuellement une réflexion portant sur de nombreux points, est engagée afin de vérifier s’il y a eu décadence ou mutation. Les pages suivantes de ce chapitre « Histoire » vont témoigner de cette réflexion.
Que signifie le mot invasion ? Le petit Larousse nous donne pour définition de ce mot, « l’action d’envahir un pays avec des troupes armées ». Mais il ne précise pas que cette action d’envahir un pays est à sens unique. Mon pays, la France, a été envahi dans le passé, mais n’a jamais envahi un autre pays. Ainsi la petite promenade que Napoléon a fait faire à la Grande Armée en 1813 est appelée « Campagne de Russie » et non « Invasion de la Russie » Et de même le mot « invasion » n’est pas utilisé concernant nos guerres coloniales. On lui préfère les mots « envoi de troupes » ou « soutien à tel roitelet » En conséquence, le mot « invasion » n’est pas tout à fait neutre. Et si on tient à l’employer, il faut équilibrer les deux camps. C’est-à-dire se poser la question : s’il y a eu invasion de l’empire romain par des peuples barbares, l’inverse s’est-il produit aussi, invasion des pays barbares par les romains ?
J’ai découvert récemment sur Wikipedia qu’il y avait, sur ce sujet, débat entre historiens français et allemands, les premiers gardant le mot, « invasions barbares », les seconds préférant le mot, « migrations de peuples ».
A l’heure actuelle mon opinion est que, quelque soit le mot adopté, il y a eu exagération des effets de ces « invasions » ou de ces « migrations ».
(Voir la page « Qui est le plus grand spécialiste des Mérovingiens ?).
Voir ci-dessus le mot de Mérovingien. Il y a cependant une grande différence car le mot « Ottonien » ne s’applique pas à un peuple mais à une dynastie d’empereurs d’Allemagne désignés sous le nom de « Othon ». Et comme ces empereurs ont entrepris la construction d’une série de cathédrales, on qualifie d’ottoniennes celles-ci ainsi que d’autres églises analogues.
- Je croyais que les papes étaient les
évêques de Rome.
Je découvre que, au temps de Sidoine Apollinaire, le nom de « pape » a été donné à d’autres évêques que celui de Rome. Plus tard, aux évêques métropolitains (archevêques). L’appellation n’a été attribuée aux seuls évêques de Rome que vers le début du VIIesiècle.
J’en déduis que la prééminence de l’évêque de Rome sur les autres évêques ne se serait faite que tardivement, vers le VIIesiècle. Il est néanmoins possible que les relations entre l’évêque de Rome et les autres évêques aient subi des fluctuations au cours du temps. Ainsi les premiers saints évangélisateurs de la Gaule (vers 250) comme Saturnin de Toulouse ou Paul de Narbonne étaient des envoyés de l’évêque de Rome.
Par contre, on découvre, en lisant l’œuvre de Grégoire de Tours, que plus de deux cent ans plus tard, les évêques sont, soit désignés par les fidèles, soit cooptés. Dans tous les cas, la désignation doit recueillir l’assentiment du collège des évêques dépendant du métropolitain et(ou) l’accord des autorités laïques (roi, comte, duc). Mais l’évêque de Rome semble ne pas intervenir dans cette désignation.
Je croyais que la persécution des Chrétiens s’était déroulée durant les débuts de l’ère chrétienne jusqu’aux environs de l’an 300.
Je découvre que les textes historiques (laïcs) sont très silencieux sur tout ce qui concerne les chrétiens des premiers siècles. On en parle au premier siècle (surtout en mal). Et puis, presque plus rien pour les siècles suivants. Le paradoxe vient du fait qu’on en parle aussi très peu après le règne de Constantin durant environ un siècle. Comme si les chrétiens n’avaient jamais existé. Ou plutôt comme si cette période avait laissé un si mauvais souvenir qu’il était préférable de ne pas en parler. On découvre aussi (ou plutôt on devine) que, durant les trois premiers siècles, les persécutions n’ont pas été constantes et d’égale intensité. Il y a eu des périodes de calme relatif durant lesquelles le christianisme s’est redressé et fortifié. Mais ces périodes de calme n’expliquent pas le silence postérieur à la décennie 330. On sait qu’il y a eu des divisions profondes entre les chrétiens qui avaient renié leur foi et ceux qui n’avaient pas cédé (hérésie donatiste). On devine aussi que la réforme de Constantin a dû s’accompagner de vengeances vis-à-vis des persécuteurs des chrétiens.
J’en déduis que l’histoire des persécutions des chrétiens ne s’est très probablement pas arrêtée à l’avènement de Constantin. Ces persécutions ont dû laisser des séquelles durables et pendant longtemps il a dû être dangereux d’afficher publiquement sa foi, que l’on soit chrétien ou que l’on soit païen. Il faut aussi noter que la fin (officielle) des persécutions correspond à une montée en puissance des hérésies (le donatisme déjà cité, le priscillianisme, l’arianisme) et à une disparition du paganisme. Il est possible que les descendants des païens qui avaient persécuté les chrétiens, devenus interdits de religion aient opté pour l’une ou l’autre des hérésies afin de s’opposer au catholicisme (on devrait plutôt parler d’orthodoxie) triomphant. Dans tous les cas, il faudra effectuer une analyse précise afin d’estimer les époques de persécutions probables et l’intensité de ces persécutions, les époques de calme relatif, les temps de conflits entre chrétiens et autres religions, entre catholiques orthodoxes et hérétiques.
Je croyais que la religion des romains était unique et inamovible au cours des temps. Qu’il y avait de plus une religion « impériale » ; c’est-à-dire que l’empereur était considéré comme un dieu.
Je découvre que la réalité est apparemment plus complexe. Au fur et à mesure de leurs conquêtes les romains auraient intégré des dieux locaux en leur donnant le nom de leurs propres dieux. Sans toutefois pouvoir leur donner les attributs de leurs dieux ou les mythes qui leur étaient associés. Si bien que, pour le même nom de dieu, on peut avoir plusieurs légendes ou plusieurs attributs. A remarquer qu’on à la même chose au niveau des saints chrétiens : le même saint peut être vénéré dans plusieurs endroits différents avec plusieurs vies différentes (par exemple Saint-Nicolas). Cette religion romaine (on devrait plutôt dire : ces religions romaines) a (ont) beaucoup évolué au cours du temps. Il y a eu d’abord une période d’intégration des religions étrangères. Il est probable que ces religions qui avaient adopté pour leurs dieux des noms de dieux romains ont fait évoluer la religion romaine. Puis, lorsque l’empire a commencé à décliner les peuples colonisés par les romains ont repris leurs anciens dieux. Quant aux romains (ou les élites des peuples colonisés), leurs croyances ont évolué. On constate en effet que les romains attachent plus d’importance aux obsèques. Les sépultures sont plus riches qu’auparavant et les thèmes d’ornementation développent l’idée d’une existence après la mort. Il y a aussi l’importance donnée aux religions orientales. Le christianisme, bien sûr, mais aussi le judaïsme, les cultes d’Isis, de Cybèle, de Mithra, le mazdéisme. Toutes religions qui invitent à croire en un Dieu unique. En règle générale, l’empereur n’est pas considéré comme un Dieu mais comme « pieux ». Il semblerait que la vénération qu’on lui devait était comparable à celle, actuelle, des catholiques pour leur pape.
(Voir ci-dessus à Empire Romain).
Je croyais que les Saints n’ont pas existé ! Oh bien sûr j’exagère un peu en disant cela. A la différence de certains historiens du XIXesiècle qui ont affirmé que l’homme Jésus était une pure invention, j’étais bien persuadé de l’existence de Jésus-Homme, et, avec lui, de ses apôtres. J’étais aussi convaincu de l’existence de saints ayant vécu à une époque plus proche de la nôtre comme saint Pie X , Saint François d’Assise ou Saint Bernard de Clairvaux. Mais entre ces deux groupes de saints dont l’existence est hautement probable, il y avait une foule de saints dont la légitimité me semblait douteuse. Prenons le cas de Saint Aphrodise, premier évêque de Béziers. Les légendes attachées à ce saint étaient tellement extraordinaires que son existence pouvait être remise en cause. Et ce, d’autant plus que le premier texte le mentionnant était postérieur de près de cinq siècles à son supposé martyre. Pour moi donc, l’existence d’un grand nombre de saints locaux devait être remise en cause. Leurs légendes étaient pour moi les résultats d’une invention purement artificielle au cours du premier millénaire.
- Cependant je découvre, à la lecture de
Grégoire de Tours, que de nombreux saints (Saint-Félix
évêque de Nantes (image
18), saint Apruncule, évêque de Clermont, et tant
d’autres) ont eu une existence réelle car ils étaient les
contemporains ou de peu les aînés de Grégoire : contester
cette existence reviendrait à remettre en question celles
de beaucoup de laïcs célèbres tels que Clovis, Chilpéric,
Frédégonde, et de tant d’autres princes ou princesses.
Donc toute une partie de l’histoire de France que l’on
s’efforce d’inculquer aux enfants.une langue parlée par
les occupants primitifs de la région avant la venue
d’envahisseurs indo-européens.
Mais il y a plus ! Grégoire cite Saint Hilaire de Poitiers qui vivait deux cent ans avant lui. Or l’existence de Saint Hilaire est confirmée par d’autres sources. Ce qui laisse envisager que Grégoire reste compétent pour des informations bien antérieures à son époque. Et donc l’envoi par l’évêque de Rome, vers l’an 250, des sept saints évangélisateurs de la Gaule (Saturnin à Toulouse, Saint Paul à Narbonne, Martial à Limoges .. .) est, pour moi, envisageable, alors que, auparavant, je l’avais estimée peu crédible. Cette opinion est confirmée par le fait que Grégoire n’assortit pas ses vies de saints, de légendes fantaisistes (du moins pas trop fantaisistes).