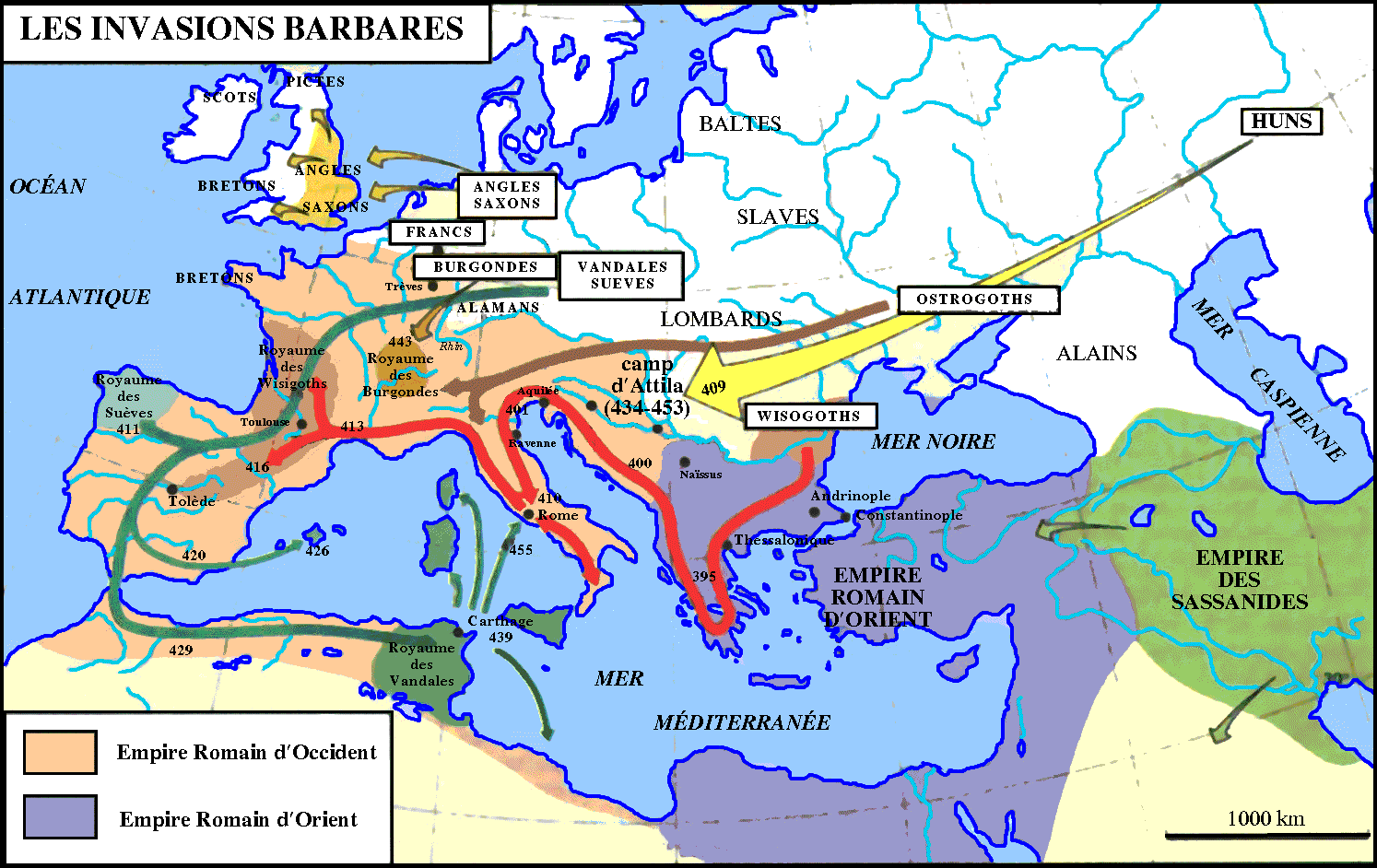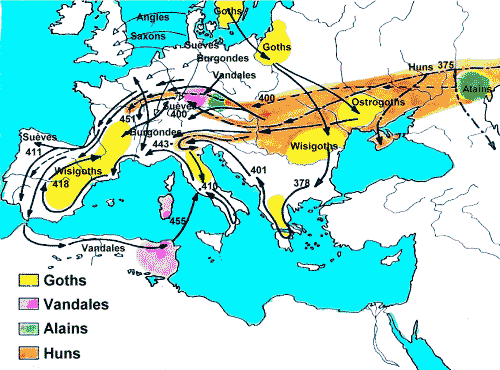Concernant le Premier Millénaire, l’Histoire de France est fausse
Le texte ci-dessous a été écrit en vue d’être présenté lors d’une conférence. Pour son auteur, il s’agit d’un texte majeur qui bouleverse toutes les convictions qu’il avait lui-même et que chacun peut qu'avoir sur l’histoire et l’architecture du premier millénaire.
« Vous serez sans doute surpris que, très souvent, je parle à la première personne. Et peut-être certains y verront l’effet d’un orgueil démesuré.
Mais parler à la troisième personne pourrait vous laisser croire que les événements que je décris se sont réellement passés tels que les dis. Ce serait transformer en certitudes mes propres incertitudes. Je voudrais vous raconter mon cheminement. Ce cheminement c’est celui d’un simple particulier, un « rien du tout » qui ne fait pas partie du sérail des historiens, mais qui cherche à connaître un peu d’histoire du premier millénaire. Et qui découvre au fur et à mesure de ces recherches que cette histoire n’était pas du tout celle qu’il avait imaginée ou qu’on lui avait décrite. Voici donc comment cela s’est passé.
A la suite de recherches effectuées sur l’architecture des églises de la ville de Béziers ou de la région j’ai réalisé que certains de ces édifices pouvaient être beaucoup plus anciens que ce que l’on imaginait auparavant, qu’ils étaient sûrement antérieurs à l’an mille.
Mes connaissances sur cette période étant très limitées, et espérant découvrir des choses intéressantes dans les écrits des historiens anciens j’ai décidé d’effectuer une recherche qui ne devait pas excéder 6 mois car j’envisageais de poursuivre dans d’autres directions. Cependant, plus de deux ans après, cette lecture n’est pas encore achevée. Néanmoins, elle a été pour moi très fructueuse.
Au début je voulais étudier la période comprise entre les années 400 et 1000, période dite «des « Grandes Invasions ». Puis, estimant que l’on ne pouvait bien comprendre cette période si on ne connaissait pas au moins une partie de l’histoire romaine, j’ai étendu cette étude à 200-1100. Et enfin j’ai décidé de démarrer dès l’an 1 de notre ère. Du premier siècle se détachaient deux historiens Suétone et Tacite. Pour faire plus rapide, j’ai opté tout à fait au hasard pour Suétone. Mais j’avais décidé auparavant que, par la suite je lirais systématiquement tous les historiens des siècles suivants.
En conséquence avant même de commencer j’avais choisi d’étudier successivement Suétone, l’Histoire Auguste, des auteurs mineurs comme Ausone, Sidoine Apollinaire et Venance Fortunat. Viendraient ensuite les deux historiens dits mérovingiens Grégoire de Tours et Frédégaire. Et puis y aurait sans doute des historiens dits carolingiens. Et le tout, à faire en 6 mois. Je savais que Suétone me prendrait pas mal de temps mais pour le reste ce serait sans doute beaucoup plus rapide. Donc j’ai attaqué cette lecture d’auteurs anciens. Dans le même temps je cherchais à savoir s’il existait des historiens dont j’ignorais l’existence. Et j’en ai trouvé! J’ai pris des notes bibliographiques , et, afin de ne rien omettre dans un éventuel futur livre, j’ai commencé à en rédiger la bibliographie en mentionnant les références des textes anciens que je venais de lire Un beau jour, comme je partais en vacances et que je n’avais rien d’autre à faire j’ai décidé d’emporter avec moi le livre de Pierre Grimal intitulé « La civilisation romaine » (collection « Champs Flammarion »).
Je voulais vérifier si mon opinion correspondait à celle de l’auteur. J’ai constaté de nettes divergences de vues entre l’historien et moi. Mais ce n’est pas là le plus important. En fait, le plus important s’est trouvé dans la bibliographie. En préambule de cette bibliographie l’auteur nous précise que l’ensemble de tout ce qui a été publié sur la civilisation romaine est immense et que les indications bibliographiques qu’il propose au lecteur ne sont qu’une petite partie de cette documentation. Et il cite tous les ouvrages … de la page 331 à la page 364. Soit 33 pages. Sachant que chaque page mentionne environ une vingtaine d’ouvrages on arrive à plus de 600 livres. Bravo! Félicitations à l’auteur d’avoir lu tout cela. Le mérite est d’autant plus grand que, outre le français, certains ouvrages sont écrits en anglais, d’autres en allemand et d’autres encore en italien ou en espagnol. Mais … aucun n’est écrit en latin.
Ainsi, revenons à M Grimal, dont le livre est intitulé « La Civilisation Romaine ». Il commence par la fondation de Rome vers 700 avant J.C qu’il décrit longuement. Puis il décrit tout aussi longuement les périodes successives : les Tarquins, la République. les Gracques, l’Empire. Et il s’arrête brusquement à Marc Aurèle vers la fin du deuxième siècle de notre ère. En conséquence, pour lui, la civilisation romaine commence 700 ans avant Jésus Christ et finit vers l’an 200 après Jésus-Christ. En ce qui me concerne j’ai une conception un peu différente. Pour moi une civilisation est reconnaissable aux monuments qu’elle a laissés. Comme je ne connais pas de monument romain antérieur à l’an 1 de notre ère. Et que, par contre j’en connais datant du IIIe ou du IVe siècle, j’estime qu’on ne peut parler de civilisation romaine que pour une période comprise entre le deuxième siècle avant Jésus Christ et le Ve siècle après Jésus-Christ. Voire même le VIIe siècle comme mes propres recherches me permettent de l’envisager. En résumé pour M Grimal de -700 à + 200, et, pour moi, de -200 à + 700. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y a un décalage entre nos deux opinions : 500 ans. Mais bien sûr, chacun est libre de celles-ci.
Cette expérience montre qu’il peut exister une distorsion entre ce que croient et enseignent les historiens, et ce que chacun d’entre nous s’imagine de cette histoire ou l’interprète à sa façon. Surtout une question se pose : qu’en est-il du rapport entre ces diverses connaissances (de l’historien et du profane) et la vérité historique. Cette vérité historique, je ne prétends surtout pas la détenir. Je pense néanmoins qu’on peut s’en approcher à partir de l’étude comparée des historiens anciens et des données archéologiques modernes. Il est fort possible que notre connaissance actuelle de l’histoire ancienne aurait pu avoir été forgée, non pas à partir de l’étude directe des auteurs anciens, mais à partir de la relecture qu’en ont fait des auteurs modernes. Et ce, au moins depuis la Renaissance. Je vais donc essayer de présenter les découvertes du naïf que je suis au travers d’une série de remises en question de certaines certitudes que je m’étais formées. Ces opinions étaient certes les miennes Mais je pense aussi que pour un grand nombre d’entre vous elles sont aussi les vôtres. Je croyais initialement que: 1) Les historiens latins du premier millénaire sont Suétone et Tacite. Avec sans doute quelques autres de bien moindre importance que les deux premiers.
En lisant les textes de Suétone je l’ai trouvé très déroutant: la plupart des empereurs qu’il décrit sont bourrés de qualités dans une page et bourrés de défauts dans la page suivante En conséquence il m’a semblé peu fiable sur certains points. Les écrivains de l’Histoire Auguste sont globalement comparables à Suétone. Plus tard je me suis résolu à lire Tacite qui s’est révélé plus fiable que Suétone. Cependant la surprise est venu des autres, ceux dont j’ignorais l’existence auparavant: Eutrope, Ammien Marcellin, Pomponius Mela. A mon avis tous trois soutiennent la comparaison avec Tacite. Ils ne sont pas seuls. Il y en a d’autres de moins grande envergure Zosime, Zonare, Sextus Rufus. Olympiodore, Xyphilin. Une autre surprise a été de découvrir, Jornandès qui a écrit une histoire des Goths. Ausone, Sidoine Apollinaire et Venance Fortunat sont plus des hommes de lettres que des historiens. Cependant, certains de leurs écrits peuvent donner des indications historiques pertinentes. Par ailleurs je n’ai pas compris le discrédit dont ils faisaient l’objet.
D’autres comme Aurelius Victor sont venus s’ajouter à cette liste un peu plus tard. Et il risque d’y en avoir d’autres encore ! Je me suis demandé comment il se faisait que j’ignore l’existence de ces auteurs. Pour moi, la réponse est simple: ils ont vécu du IVe au VIe siècle de notre ère c’est-à-dire bien après le IIe siècle. En conséquence et si on adopte le point de vue de Monsieur Grimal et sans doute de beaucoup d’autres historiens, ils se situent hors de la civilisation romaine et donc, ils ne sont ni civilisés, ni romains. 2, Grégoire de Tours un historien mineur.
Enfin j’en suis arrivé à Grégoire de Tours. Et là la surprise a été encore plus totale. C’était tout le contraire de ce que j’avais appris ou que je croyais savoir. Je considérais que ce Grégoire de Tours était un historien insignifiant. L’historien du vase de Soissons! Et, rendez-vous compte! Il ne nous a même pas dit qui avait cassé ce fameux vase de Soissons! J’ai donc découvert que la fameuse histoire du vase de Soissons c’étaient deux lignes … sur des centaines de pages. De toute son Histoire des Francs je ne connaissais que ces deux lignes. Plus quelques petites informations sur la conversion de Clovis ou les méchancetés des sorcières Frédégonde et Brunehaut. Par contre j’ignorais beaucoup d’autres choses. Afin de vous montrer l’importance de Grégoire je vais seulement développer deux exemples. Premier exemple: au cours de mes lectures mon attention s’est portée sur les évêques cités par Grégoire de Tours. Et comme à chaque fois il mentionne la ville de résidence de l’évêque j’ai relevé les noms de tous les évêchés. Puis voyant que cette liste semblait importante j’ai décidé de comparer cette liste avec la liste des localités citées par Suétone, et Tacite.
Je vais seulement vous donner le résultat pour ce qui concerne la lettre « A ». Voici les villes citées par Suétone et dont le nom commence par la lettre « A »: Actium (bataille), Alexandrie, Albe, Allia (bataille), Antioche, Antium, Apollonie, Aquilée, Aricie (?), Arles, Asture (?), Athènes, En ce qui concerne les villes citées par Tacite: j’en ai compté 22. On en retrouve certaines déjà citées par Suétone. Quant aux autres c’est un peu de la même veine. Voici à présent les villes citées par Grégoire de Tours. Rappelons que ce sont des sièges épiscopaux. C’est-à-dire des villes d’une certaine importance alors que les localités citées par Suétone peuvent être d’importance secondaire. Rappelons aussi que des villes même importantes ont pu ne pas avoir été enregistrées dans cette liste parce que Grégoire n’y mentionne pas la présence d’un évêque En Allemagne : Aix la Chapelle ; En Italie : Aquilée ; En Suisse : Agaune, Avenches; En Syrie: Antioche En France Les villes épiscopales de Aire, Aix, Agde, Agen, Albi, Amiens, Angers, Angoulème, Arles, Arras , Auch, Aurillac, Autun, Auxerre, Avignon, Avranches. Et surtout la ville qu’il cite le plus souvent après celle de Tours : Arverne, qui n’est autre que l’actuelle Clermont–Ferrand. A ma connaissance il oublie seulement quatre villes épiscopales: Ajaccio, Alençon, Annecy, Apt. A remarquer que cette masse de renseignements n’est pas due à un bilan exhaustif. Les noms apparaissent au hasard d’anecdotes et si Agde est citée à 2 reprises, Béziers n’est pas citée comme évêché. Pourtant c’en était un.
Je vais maintenant prendre un autre exemple. Concernant cette fois-ci trois des prédécesseurs de Grégoire à l’évêché de Tours. « Le quatorzième évêque sacré fut Francille, sénateur, citoyen de Poitiers. Il avait une femme, nommée Claire, mais point d’enfants ; tous deux étaient fort riches en biens de campagne, qu’ils donnèrent en grande partie à la basilique de Saint-Martin ; ils en laissèrent quelques-uns à leurs parents. Il siégea deux ans et six mois, puis mourut et fut enseveli dans la basilique Saint-Martin. Le quinzième fut Injuriosus, citoyen de Tours, d’une naissance inférieure, mais libre. De son temps la reine Clotilde passa de ce monde à l’autre. Il acheva l’église de Sainte-Marie dans les murs de la ville de Tours. De son temps fut bâtie la basilique de Saint-Germain et furent fondés les bourgs de Neuilly et de Luzillé. Il institua dans l’église des prières à dire à Tierce et à Sexte, et qui, par la grâce de Dieu, y sont encore conservées. Il siégea seize ans, onze mois et vingt-sept jours, puis mourut et fut enseveli dans la basilique Saint-Martin. Le seizième fut Bodin, référendaire du roi Clotaire. Il avait un fils et était fort adonné à l’aumône ; il partagea aux pauvres plus de vingt mille sous d’or laissés par son prédécesseur. De son temps fut construit un autre bourg de Neuilly. Il fonda la mense canonicale. Il siégea cinq ans et dix mois, puis mourut et fut enseveli dans la basilique de Saint-Martin. » Ces quelques phrases révèlent son style d’écrivain : clair, précis, qui ne s’embarrasse pas de fioritures, qui va direct à l’essentiel. Je ne sais pas si chacun d’entre vous est arrivé à appréhender la densité d’informations que l’on obtient ici.
Je n’en retiendrai qu’une: « Bodin fonda la mense canonicale » Je me rappelle que c’est une des questions que j’avais posée ici-même au conférencier, M Luc Baby. « De quand date l’ordre des chanoines ? ». On a ici un élément de réponse. En conséquence de toutes ces observations je suis forcé de dire que, loin d’être considéré comme un historien de second plan, Grégoire de Tours doit être considéré comme l’historien majeur de cette période. En tout cas il nous fournit plus d’informations que Tacite et Suétone réunis. 3 La république c’est la république et l’empire c’est l’empire… … Il ne faut pas confondre les torchons et les serviettes! Je pensais que, à l’image de ce que nous avons connu en France durant deux siècles, la république romaine et l’empire romain étaient des systèmes politiques radicalement différents presque antinomiques même s’il peut exister plusieurs formes d’empire et plusieurs formes de république Imaginez donc ma surprise lorsque, lisant un texte du IIIe siècle de notre ère j’ai vu le mot de « république ». Comment se fait-il que, en pleine période impériale, on parle encore de « république »? Et ce mot de « république » je l’ai relu ensuite un peu plus loin. En voyant cela je suis revenu à Suétone qui a écrit la « Vie des douze Césars » pour voir s’il utilisait les mots « Empire », ou « Empereur » mais je n’ai découvert que les mots « César» ou « Auguste ». pour désigner ce que l’on appelle maintenant des « empereurs ». Quant à Tacite il parle bien « d’imperium » pour dire que quelqu’un a pris ou s’est vu confier un commandement mais on ne sait de quel type de commandement il s’agit: un corps d’armée? une armée? une nation? A cela s’est ajouté le fait que Francille évêque cité précédemment par Grégoire de Tours avait été un sénateur. Comment se fait-il qu’il y ait un sénateur au VIe siècle? Je croyais que le Sénat avait été supprimé dès l’avènement de l’empire.
En conséquence j’en suis venu à me poser la question: y a -t-il eu une république dans l’empire romain ou bien un empire dans la république romaine? C’est à dire quels étaient les pouvoirs exacts de ceux qu’on a désigné sous le nom d’empereurs? Et quels étaient aussi les pouvoirs des sénateurs ? ou des consuls ? Car, pour moi, il est difficile d’imaginer qu’une classe sociale privilégiée puisse se maintenir pendant cinq siècles sans être détentrice d’un quelconque pouvoir. 4 L’empire romain a été détruit « sous le coup de boutoir » des invasions barbares Cette phrase désormais célèbre a été employée par de nombreux historiens et semble faire consensus. En me fiant à cette phrase et à ce qu’affirmaient, par ailleurs, les mêmes historiens j’avais imaginé le processus suivant : dans un premier temps l’empire romain est en expansion. Il n’y a dons pas d’invasion barbare. Il atteint son apogée vers le deuxième siècle. A partir du IIIe siècle de notre ère une série d’invasions successives désorganisent puis finissent par détruire l’empire romain. Vers l’an 1000 on assiste aux prémisses d’un rétablissement. Mais celui-ci ne sera complet qu’à la fin du XIIe siècle. Voilà donc une explication proposée de la décadence de l’empire romain. Elle semble avoir été admise par tous les historiens. En tout cas si certains d’entre eux ne sont pas d’accord on ne les entend pas beaucoup. Le problème c’est que cette explication ne résiste pas à l’analyse fine des textes historiques et à une foule de petites questions ou de raisonnements logiques. Prenons seulement l’exemple du mot « coup de boutoir » qui suggère l’idée de chocs successifs répétés et réguliers comme une porte de ville que l’on essaye d’enfoncer à l’aide d’un bélier. Après les coups successifs du bélier et sans attendre que les assiégés aient eu le temps de renforcer la porte, celle-ci finit céder et la place est investie.
Mais revenons au premier millénaire: après la période calme de 200 ans, c’est au tour des Arabes puis, plus de 100 ans après les Vikings. Nouveaux « coups de boutoir » sur le continent européen ? Seulement on apprend par la même occasion que les uns et les autres n’auraient envahi que des parties de l’Europe. Que s’est-il passé dans les parties qui n’ont pas été envahies ? ni les Arabes ni par les Vikings ? Faut t’il s’imaginer que personne n’a eu l’idée de les occuper pendant 500 ans ? Poursuivons la description. Les incursions des Vikings se sont terminées au début du Xe siècle et puis plus rien jusqu’à l’an mille. Et là on apprend que, tout d’un coup, à partir de cette date, s’effectue une reconstruction du monde occidental car, auparavant, « tout a été détruit par les invasions barbares ». On se trouve donc en face d’une série d’incohérences et obligé d’envisager que la phrase précédente « L’empire romain a été détruit sous le coup de boutoir des invasions barbares » ait toutes les chances d’être fausse. S’il y a eu réellement destruction du monde romain alors les causes sont à rechercher ailleurs que dans les seules invasions barbares. Quelles pourraient être ces causes ? Tout d’abord, Il nous faut reconnaître qu’il est beaucoup plus facile de dénoncer un ennemi extérieur que d’avouer qu’il existait des conflits intérieurs. Pourtant ces conflits intérieurs apparaissent bien à travers les textes. Et ils sont même plus fréquents que les guerres avec les barbares. D’ailleurs on s’aperçoit que les incursions de barbares se produisent le plus souvent après qu’il y ait eu des conflits intérieurs à l’empire, - c’est-à-dire quand l’empire est affaibli par les divisions- et non avant. Les épidémies souvent signalées ont pu être aussi causes de déclin. Plus encore il semblerait que les conditions climatiques aient provoqué la ruine de certaines régions. En particulier au Moyen-Orient et en Afrique avec un accroissement de la désertification.
Cependant il nous faut envisager une autre hypothèse : qu’il n’y ait pas eu destruction de la civilisation romaine! 5) Il y a eu décadence de la Civilisation Romaine à partir du IIIe siècle de notre ère Là encore la phrase est d’une telle évidence que sa remise en question doit apparaître à chacun d’entre vous comme totalement absurde. C‘était ce que je pensais il y a seulement 2 ans. Pourtant j’avais lu quelques années auparavant un petit livre de l’historien Henri-Irénée Marrou intitulé « Décadence romaine ou antiquité tardive ? » (Collection Champs Flammarion), mais je n’y avais pas prêté l’attention qu’il méritait. L’auteur y montre que ce que l’on a appelé la décadence de l’Empire Romain n’est en fait qu’un changement de système. Néanmoins il n’applique cette démonstration qu’à la partie artistique. Selon lui il n’y aurait pas eu de décadence de la mode ou des arts mais une modification profonde des conceptions artistiques ou des mœurs. Une idée analogue est en train de prendre jour. Cette fois-ci elle ne concernerait pas le seul domaine artistique mais l’ensemble de tous les domaines. Il n’y aurait pas eu disparition d’un monde mais refondation de ce monde sur des bases nouvelles. Seraient concernées les techniques, les structures politiques, sociales et religieuses, l’organisation du territoire et enfin l’architecture des monuments publics.
Conclusions 1 Au cours de mes lectures et des recherches qui les ont suivies il m’est apparu que l’histoire de la France du premier millénaire avait toutes les caractéristiques d’une légende. Je voudrais tout d’abord vous dire ce que je définis comme étant une légende : c’est, à l’origine, une histoire vraie mais qui a été tellement déformée par des interprétations successives que l’histoire vraie a été oubliée. Et donc, selon moi, c’est ce qui se serait passé concernant l’histoire du premier millénaire. Une histoire vraie qui aurait été déformée par des intervenants successifs 2 Mais comment se fait-il que l’histoire du premier millénaire ait été transformée en légende?. Plusieurs pistes sont possibles. Il y a d’une part la rareté des textes entre le VIIe siècle et le XIe siècle. Cette rareté pourrait expliquer quelques interprétations un peu trop fantaisistes. Mais elle n’explique pas tout. Elle n’explique pas en particulier le fait que les textes les plus riches comme ceux de Grégoire de Tours aient été très insuffisamment exploités. Une autre explication sans doute meilleure peut être avancée: la transformation d’une histoire en légende n’est pas un processus purement aléatoire. C’est une création humaine en vue de donner un sens à une histoire qui, a priori, n’avait pas de sens. En ce qui concerne l’histoire du premier millénaire cette quête de sens peut être la recherche d’un mythe fondateur de l’identité française. Comment s’est donc constituée la France ? La France ne manque pas de pères fondateurs : Vercingétorix, Clovis, Dagobert, Charlemagne.
Mais il y a un très gros problème : le dernier d’entre eux, Charlemagne était certes roi des français mais aussi empereur des allemands. Horreur ! les français seraient donc de la même souche que les allemands, nos ennemis jurés? Fort heureusement apparaît, vers l’an mille, Hugues Capet qui renverse le dernier empereur allemand et devient roi des français. Et c’est un bon français puisqu’il habite du coté de Paris. En conséquence l’histoire de France commence à l’an mille, et ce, dans le bassin parisien. Conséquence immédiate de cette analyse: hormis quelques monuments romains rien n’a été construit en France avant la date de l’an 1000. Pendant 700 ans les français se sont tournés les pouces en attendant Hugues Capet ! L’histoire de l’Espagne est tout aussi instructive. En effet l’identité espagnole s’est forgée sur l’idée de « reconquista » : la reconquête de l’Espagne sur les arabes qui s’est faite dès le IXe siècle, à partir du royaume des Asturies. Conséquence : Il existe en Espagne des monuments antérieurs à l’an 1000. Ils sont, devinez où ? … dans les Asturies !
Par contre il n’existe pas de monument arabe datant de cette période. Certes il existe quelques monuments inspirés de l’art arabe. Mais ce sont des chrétiens, appelés mozarabes, qui les ont construits. En France, comme en Espagne, ou dans d’autres pays, la quête de sens en vue de forger une identité nationale a pu orienter la recherche historique. Parfois même, sans que les historiens aient une pleine conscience de ces orientations. D’autres quêtes de sens peuvent conduire à des manipulations de l’histoire. Ainsi lorsque Montesquieu écrit son ouvrage sur les « Causes de la Grandeur et de la Décadence des Romains » fait-il une œuvre d’historien ou essaye-t-il de faire passer ses propres idées philosophiques ou politiques ?
Conclusion en guise de démarches futures: Vous connaissez tous la bonne méthode pour rédiger une dissertation philosophique : thèse, antithèse, synthèse. La thèse vous la connaissiez auparavant : au début du premier millénaire il y a eu constitution d’un empire romain venu se substituer à la république romaine qui existait quelques décennies auparavant. Puis cet empire romain a été détruit sous le coup de boutoir des invasions barbares. Le redressement ne s’est effectué que à partir de l’an 1000. L’antithèse n’est autre que le thème de cette conférence : « l’histoire du premier millénaire est fausse ». Radicalement fausse ! Il reste donc à faire le plus gros travail : la synthèse. Cette synthèse ne pourra être faite que si auparavant on a accepté les termes de l’antithèse. C’est à dire si on a décidé de partir du principe que tout ce que l’on avait appris jusqu’à présent était faux. Ce n’est que par cette méthode que l’on arrivera à démêler le vrai du faux. D’ores et déjà et par petites touches les pistes de cette synthèse se dessinent. Elles permettent d’envisager que l’histoire du premier millénaire est beaucoup plus riche mais aussi beaucoup plus complexe que ce que l’on croyait auparavant. Quelles seraient donc les pistes à approfondir? Je pense qu’il faudrait écrire ou réécrire une histoire des peuples de l’antiquité tardive et, plus particulièrement, les peuples romains, goths et francs. D’autres recherches sont aussi possibles. La plus prometteuse semble celle concernant la datation des monuments issus de l’antiquité tardive et du Haut Moyen-âge.
Dans un premier temps il nous faut sortir du raisonnement redondant liant invasions barbares et destructions massives . Ce raisonnement est le suivant : les invasions barbares ont détruit tous les monuments antérieurs à l’an mille. Donc les monuments romans qui existent encore sont postérieurs à l’an mille. On peut donc les dater du XIe siècle ou du XIIe siècle. Et on déduit de cette constatation qu’il ne reste plus aucun monument antérieur à l’an mille. Ce qui prouve que les invasion barbares ont tout détruit. Présenté ainsi dans son intégralité ce raisonnement prête à sourire. Il est dénué de toute valeur car c’est le raisonnement en boucle, dit du « serpent qui se mort la queue ». Mais, comme, à chaque fois, on n’en donne que des bribes, chacune de ces bribes nous apparaît cohérente. Après avoir pris conscience de l’erreur de ce type de raisonnement, Il nous faut accepter l’idée que dès le sixième siècle de notre ère, l’actuel territoire de France était couvert de plusieurs milliers d’églises. C’est en tout cas ce qu’on peut déduire de l’œuvre de Grégoire de Tours. Et, vu que les périodes suivantes sont relativement calmes on peut penser que, après Grégoire, les constructions se sont poursuivies. Certes bon nombre de ces édifices ont totalement disparu pour diverses raisons. Mais, pour les autres, des restes importants devraient subsister dans des édifices encore debout. En effectuant des comparaisons, en évaluant les évolutions techniques ou stylistiques on doit pouvoir arriver à dater ces édifices. Sachez qu’une telle datation me tient à cœur. D’ores et déjà, une étude a été effectuée à partir d’une échantillon de plus de 1950 édifices situés en Europe. A la date du 25 septembre 2015 ont été sélectionnés 227 édifices répondant aux critères suivants : ils sont situés en France, ils présentent des caractères romans, ils mesurent plus de 10 mètres de long et ma visite de chacun d’entre eux a concerné plus de 60% de l’édifice. Sur ces 227 édifices, 107 sont antérieurs à l’an mille avec une probabilité supérieure à 50%. Seulement 8 de ces derniers, la plupart en ruines, avaient été auparavant identifiés comme antérieurs à l’an 1000. Cette étude permet d’envisager que le nombre des monuments datant d’une période antérieure à l’an mille doit être multiplié au moins par 10 par rapport à l’effectif précédemment estimé. Elle permet aussi d’envisager qu’une classification de l’ensemble des édifices romans, en France et en Europe, soit plus de 10000, est envisageable Il est absolument nécessaire que ces recherches se poursuivent et s’amplifient afin de réduire les marges d’incertitude. J’espère avoir l’occasion d’exposer les résultats de ces recherches dans une prochaine conférence. Mesdames et messieurs je vous remercie de votre attention. »